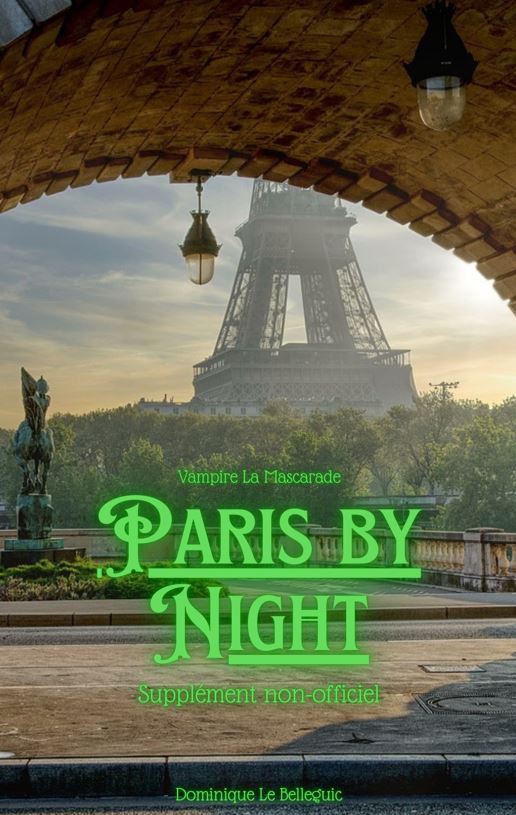On en est où de la fin du monde ?
Des fois, la réalité dépasse la fiction. Alors que certaines théories annoncent la fin de nos sociétés, certains ont déjà pris les devants.
Il sera une grande source d’inspiration pour tout scénario survivaliste contemporain, que ce soit pour avant l’apocalypse ou une fois que celle-ci eu lieu.
Quand les super-riches se préparent à l’apocalypse : l’enquête de The New Yorker
Parmi les Américains les plus fortunés de la Silicon Valley, de New York et d’ailleurs, on se prépare à l’effondrement de notre civilisation.
Steve Huffman, le cofondateur de 33 ans et CEO de Reddit, dont la fortune est évaluée à 600 millions de dollars, était myope jusqu’en novembre 2015 lorsqu’il décida de recourir à la chirurgie laser. Il est passé sur le billard non pas pour des raisons pratiques ou esthétiques, mais pour une raison dont il ne parle pas souvent : pour espérer augmenter ses chances de survivre en cas de désastre, qu’il soit naturel ou provoqué par l’homme. « Si c’est la fin du monde, et même si ce n’est pas la fin du monde, mais que nous connaissons des soucis, ce sera la merde pour se procurer des lentilles de contact ou des lunettes, a-t-il déclaré récemment. Sans cela, je suis niqué (sic). »
Huffman, qui vit à San Francisco, a de grands yeux bleus, d’épais cheveux blonds foncés et une mine affichant une curiosité insatiable. À l’université de Virginie, c’était un pro de la danse de salon qui avait hacké le site Web de son compagnon de chambre en guise de blague. Il se tracasse moins d’une menace spécifique, comme un tremblement de terre sur la faille de San Andreas, une pandémie ou une bombe sale, que de ses conséquences, de « l’effondrement temporaire de notre gouvernement et de ses structures », comme il se plaît à le dire. « Je possède plusieurs motos. J’ai un stock d’armes et de munitions. De la nourriture. Je pense qu’avec tout cela, je peux me retrancher dans ma maison pendant un bon bout de temps. »
Le survivalisme, qui consiste à se préparer à l’effondrement de notre civilisation, a tendance à faire jaillir des clichés : celui de l’homme des bois un peu barjo, de l’hystérique qui entrepose des palettes de conserves de petits pois, du Nostradamus annonçant la fin du monde. Mais durant ces dernières années, le survivalisme s’est répandu dans des quartiers plus huppés, s’enracinant notamment dans la Silicon Valley et à New York City parmi les cadres de haut vol, des technologiques, les gestionnaires de hedge funds et autres profils aux revenus similaires.
Le printemps dernier, alors que la campagne présidentielle exposait des clivages de plus en plus toxiques aux États-Unis, Antonio Garcia Martinez, ancien chef de produit de Facebook qui vit à San Francisco, a acheté cinq acres boisées sur une île du nord-ouest du Pacifique. Il y a envoyé des générateurs, des panneaux solaires ainsi qu’un petit arsenal de munitions. « Lorsqu’une société perd son mythe fondateur sain, elle bascule dans le chaos », m’a-t-il dit. L’auteur de Les singes du chaos (Chaos Monkeys), des mémoires acerbes sur la Silicon Valley, voulait un refuge loin des villes, mais pas totalement isolé. « Tous ces types croient qu’un gars isolé peut résister à des hordes qui vagabondent, a-t-il déclaré. Non, vous devrez former une sorte de milice locale. Vous avez besoin de tant de choses pour survivre à l’apocalypse. » Lorsqu’il a commencé à parler de son « projet de petite île » du côté de San Francisco, ses pairs sont eux-mêmes sortis du bois en expliquant les préparatifs qu’ils mènent de leur côté. « Je pense que les gens qui sont particulièrement au courant des leviers qui actionnent notre société comprennent que nous marchons actuellement sur une très fine pellicule de glace culturelle. »
Dans des groupes Facebook privés, de riches survivalistes s’échangent des conseils sur les masques à gaz, les bunkers et les lieux à l’abri des effets du changement climatique. L’un des membres, responsable d’une société d’investissement, m’a déclaré : « J’ai un hélicoptère dont le réservoir est toujours plein. J’ai aussi un bunker souterrain avec système de filtration de l’air. » Il a déclaré que ses préparatifs sont probablement les plus extrêmes en comparaison avec ses pairs. Mais, il a ajouté : « Nombreux sont mes amis qui ont des armes, des motos et des pièces d’or. Ce n’est plus du tout rare. »
Tim Chang, directeur général de 44 ans de Mayfield Fund, entreprises de capital-risque, m’a dit : « Nous sommes tout un groupe dans la Silicon Valley. Nous nous réunissons, durant nos dîners nous parlons de nos plans de secours. Ils sont très variés, de l’accumulation de Bitcoins et d’autres cryptodevises à la façon d’obtenir un second passeport, en cas de besoin, en passant par l’achat de résidences secondaires à l’étranger qui pourraient être des lieux de refuge. » Il a déclaré : « Je vais être franc : j’investis lourdement dans l’immobilier pour générer un revenu passif, mais aussi pour avoir des plans B en cas de besoin. » Lui et sa femme, qui travaille également dans le secteur de la technologie, ont toujours des valises prêtes pour eux et leur fille de 4 ans. Il m’a dit : « Je vis avec cette sorte de scénario terrifiant : oh mon dieu, il y a une guerre civile ou un tremblement de terre géant qui coupe la Californie en deux. Nous voulons être prêts. »
Lorsque Marvin Liao, ancien directeur de Yahoo désormais partenaire chez 500 Startups, une firme de capital-risque, a envisagé ses préparatifs, il a décidé que ses caches d’eau et de nourriture n’étaient pas suffisantes. « Et si quelqu’un venait pour s’en emparer ? » m’a-t-il demandé. Pour protéger sa femme et sa fille, il a répliqué : « Je n’ai pas d’armes à feu, mais j’ai beaucoup d’autres armes. J’ai pris des cours de tir à l’arc. »
Pour d’autres, il s’agit d’une simple petite distraction de geek, une sorte de jeu de rôles de science-fiction qui a lieu dans le monde réel. Pour d’autres, comme Huffman, c’est une source de préoccupation depuis des années. « Depuis que j’ai vu le film Deep Impact », a-t-il déclaré. Le film, sorti en 1998, raconte l’histoire d’une comète qui frappe l’Atlantique et d’une course afin d’échapper au tsunami. « Tout le monde essaye de s’enfuir, mais les gens sont pris au piège dans les embouteillages. Il se trouve que cette scène a été tournée près de mon collège. À chaque fois que je roule sur cette portion de route, je me dis que je dois avoir une moto car tous les autres seront bloqués. »
Huffman est un participant fréquent de Burning Man, ce festival annuel où l’habillement est optionnel, qui a lieu dans le Nevada et où se mélangent artistes et magnats. Il est tombé amoureux de l’un de ses principes clés, « l’autosuffisance radicale », qui signifie selon lui « être heureux d’aider les autres, mais ne pas avoir besoin d’eux ». (Parmi les survivalistes, ou les preppers, comme certains se qualifient, la FEMA, l’agence fédérale de la gestion des urgences, signifie attendre stupidement une aide significative). Huffman en a conclu que, en cas de désastre, il chercherait une sorte de communauté : « Être au milieu d’autres personnes est une bonne chose. J’ai aussi cette opinion quelque peu égoïste d’être un assez bon meneur. Je serai probablement le responsable, ou au moins je ne serai pas un esclave, lorsque les choses deviendront sérieuses. »
Plus le temps passe, plus Huffman s’inquiète de la stabilité politique américaine de base et des risques de désordre à grande échelle. Il a précisé : « Une sorte d’effondrement institutionnel, tout se casse la figure, ce genre de chose. » Huffman en est arrivé à croire que notre société moderne repose sur un consensus fragile. « Je pense, dans une certaine mesure, que nous prenons tous pour acquis le fonctionnement de notre pays, la valeur de notre devise, le transfert pacifique du pouvoir, toutes ces choses qui fonctionnent parce que nous pensons qu’elles fonctionnent. Même si je pense que ces choses ont été plutôt résilientes, alors qu’on en a vu beaucoup et que nous allons encore en voir de toutes les couleurs. »
En montant Reddit, une communauté de milliers de fils de discussion devenue l’un des sites les plus populaires du monde, Huffman sait à quel point la technologie altère nos relations avec autrui, pour le meilleur et pour le pire. Il a vu, de ses propres yeux, comment les médias sociaux peuvent grossir les peurs. « C’est plus facile pour les gens de paniquer lorsqu’ils sont ensemble », a-t-il expliqué, mettant en exergue qu’« il est plus facile de se rassembler avec Internet », si bien que les gens sont au courant des risques émergents. Bien avant que la crise financière fasse la une des journaux, des signes avant-coureurs apparurent dans les commentaires des utilisateurs de Reddit. « Les gens commençaient à parler des crédits hypothécaires. Ils se faisaient du souci pour les crédits étudiants. La dette, en général, les inquiétait. On pouvait lire souvent : «C’est trop beau pour être vrai. Ça sent mauvais.» Il y a probablement de faux positifs là-dedans aussi. Mais, en général, je pense que c’est un très bon indicateur du sentiment de la population. En ce qui concerne un effondrement basé sur la perte de la foi, nous verrons les premières fissures dans les fondations sur les médias sociaux. »
Comment cette peur de l’apocalypse a-t-elle pu germer dans la Silicon Valley, un endroit connu pour sa confiance inébranlable, jusqu’au cliché, de pouvoir changer le monde pour le meilleur.
Ces pulsions ne sont pas aussi contradictoires qu’elles en ont l’air. La technologie récompense la capacité d’imaginer un futur furieusement différent, m’a dit Roy Bahat, patron de Bloomberg Beta, une société de capital-risque basée à San Francisco. « Lorsque vous êtes dans ce milieu, il est normal d’avoir une vision illimitée, ce qui vous mène vers des utopies et des dystopies », m’a-t-il dit. Cela peut inspirer un optimisme radical, comme le mouvement cryonique, qui appelle à la congélation des corps dans l’espoir que la science puisse les ressusciter un jour, ou des scénarios bien plus sombres. Tim Chang, le spécialiste du capital-risque dont les valises sont toujours prêtes, m’a dit : « Mon état d’esprit actuel oscille entre l’optimisme et la peur panique. »
Durant ces dernières années, le survivalisme s’est ancré plus profondément dans la culture mainstream. En 2012, National Geographic Channel a lancé l’émission « Doomsday Preppers », une émission de télé-réalité mettant en scène des Américains se préparant pour ce qu’ils appellent SHTF (« Shit hits the fan », lorsque « la merde atteint le ventilateur »). La première a attiré plus de 4 millions de téléspectateurs, et à la fin de la première saison, la série devenait l’émission la plus populaire de l’histoire de la chaîne. Une enquête commandée par National Geographic a montré que 40 % des Américains pensent qu’accumuler des vivres et des équipements, ou construire un abri antiaérien, est un meilleur investissement qu’une assurance vie.
La réélection de Barack Obama fut une bénédiction pour le secteur du prepping. Les Républicains inconditionnels, qui accusaient Obama d’attiser les tensions raciales, de restreindre les droits à la possession d’armes et d’augmenter la dette, ont fait le plein de fromage frais séché et congelé et de bœuf Stroganoff vantés par des commentateurs comme Glenn Beck et Sean Hannity.
Les peurs étaient différentes dans la Silicon Valley. Au même moment où Huffman, sur Reddit, voyait la crise financière se propager, Justin Kan entendait parler pour la première fois du survivalisme parmi ses pairs. Kan a cofondé Twitch, un réseau de gaming qui a été vendu à Amazon pour près d’un milliard de dollars. « Certains de mes amis disaient que l’effondrement de la société est imminent. Que nous devrions stocker de la nourriture, a-t-il déclaré. J’ai essayé de le faire. Mais nous avons seulement acheté quelques sacs de riz et cinq boîtes de tomates. S’il y avait eu un vrai problème, nous serions morts. » J’ai demandé à Kan ce que ses amis preppers ont en commun. « Beaucoup d’argent et de ressources, m’a-t-il dit. Quelles sont les choses que je peux craindre et comment m’y préparer ? C’est comme une assurance. »
Yishan Wong, l’un des premiers employés de Facebook, fut le CEO de Reddit de 2012 à 2014. Lui aussi s’est fait opérer des yeux pour des motifs survivalistes, éliminant ainsi sa dépendance, comme il l’appelle, « à une aide extérieure non durable pour bénéficier d’une vision parfaite ». Dans un e-mail, Wong m’a écrit : « La plupart des gens estiment que les événements improbables n’ont jamais lieu, or les profils techniques ont tendance à gérer le risque de façon très mathématique. » Il poursuit : « Les preppers avec un profil technique ne pensent pas nécessairement qu’un effondrement est probable. Ils estiment qu’il s’agit d’un événement très incertain, mais avec des conséquences très lourdes. Donc, en fonction des moyens dont ils disposent, ils dépensent une partie de leurs revenus pour se protéger contre cela… ce qui est logique. »
Combien de riches Américains se préparent vraiment à une catastrophe ? Difficile de le savoir précisément, car beaucoup de gens n’aiment pas en parler (l’anonymat n’a pas de prix, m’a déclaré un gestionnaire de hedge fund en déclinant l’interview). Parfois, le sujet émerge de façon inattendue. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn et investisseur majeur, se souvient avoir dit à un ami qu’il envisageait de visiter la Nouvelle-Zélande. « Oh, vas-tu y souscrire une assurance contre l’apocalypse ? », lui a demandé son ami. Hoffman lui a dit : « Hein, quoi ? » Comme il l’a alors appris, la Nouvelle-Zélande est une destination de choix en cas de cataclysme. Hoffman a expliqué : « Dire que vous achetez une maison en Nouvelle-Zélande, ça correspond à faire un gros clin d’œil, inutile d’en dire plus. Une fois que vous aurez donné la poignée de main maçonnique, ils vous diront qu’ils connaissent un gars qui vend des silos d’ICBM résistants aux radiations, le genre de chose parfaite pour votre future habitation. »
J’ai demandé à Hoffman d’estimer le pourcentage de milliardaires de la Silicon Valley qui ont souscrit à une forme « d’assurance contre l’apocalypse », que ce soit un refuge aux États-Unis ou à l’étranger. « Je dirais plus de 50 %, m’a-t-il répondu. Les motivations humaines sont complexes, je suppose que les gens se disent qu’ils ont désormais un filet de sécurité contre cette chose qui leur fait peur. Ces craintes varient, mais ils sont nombreux à avoir peur, parce que l’intelligence artificielle supprime un nombre grandissant de postes, ce qui pourrait engendrer une réaction violente contre la Silicon Valley, qui est numéro 2 au classement des endroits aux États-Unis où la richesse est la plus concentrée (le sud-ouest du Connecticut est premier). « J’ai entendu ce thème sortir de la bouche d’un tas de gens, a déclaré Hoffman. Est-ce que les gens vont se retourner contre les riches ? Vont-ils se retourner contre l’innovation technologique ? Cela va-t-il déboucher sur des troubles civils ? »
Le CEO d’une autre grande société technologique m’a dit : « Nous n’en sommes pas encore au point où les initiés du secteur se disent ouvertement les uns les autres comment ils se préparent en cas d’événement apocalyptique. Mais, cela dit, je pense que c’est logiquement rationnel et prudent. » Il a noté les vulnérabilités exposées par la cyberattaque russe contre le DNC, ainsi que la cyberattaque à grande échelle du 21 octobre qui a perturbé internet en Amérique du Nord et en Europe. « Notre approvisionnement en nourriture dépend du GPS, de la logistique, des prévisions météo, et ces systèmes dépendent souvent d’Internet, et Internet des DNS, le système qui gère les noms de domaine. » (…)
De l’autre côté du pays, des conversations tout aussi étranges ont lieu dans les cercles financiers. Robert H. Dugger travaillait en tant que lobbyiste du secteur financier avant de devenir partenaire du hedge fund Tudor Investment Corporation en 1993. Après 17 ans, il a pris sa retraite pour se focaliser sur la philanthropie et ses investissements. « Chaque personne dans cette communauté connaît des gens qui s’inquiètent de voir l’Amérique se diriger vers une sorte de révolution russe », m’a-t-il confié récemment.
Pour gérer cette peur, Dugger affirme avoir vu deux types de réponses très différentes. « Les gens savent que la seule réponse à apporter est de régler le problème de fond, a-t-il déclaré. C’est la raison pour laquelle ils sont nombreux à faire de gros dons à de bonnes causes. » Mais, en même temps, ils investissent dans une échappatoire. Il se souvient d’un dîner à New York City après le 11 septembre et l’éclatement de la bulle Internet. « Un groupe de multimillionnaires par centaines et de milliardaires discutaient de scénarios de fin de l’Amérique et de ce qu’il convenait de faire. La plupart disaient qu’ils allaient faire chauffer les turbines des avions et emmener leur famille dans leur ranch de l’Ouest ou à l’étranger. » « L’un des invités était circonspect, se souvient Dugger. Il s’est penché en avant et a dit : allez-vous aussi emmener la famille du pilote avec ? Et les mécaniciens ? Si la révolution éclate, combien de gens dont vous avez besoin allez-vous emmener avec vous ? L’interrogatoire s’est poursuivi. À la fin, la plupart étaient d’accord pour dire qu’il n’était pas possible de fuir. »
L’anxiété des élites traverse les démarcations politiques. Même les financiers qui ont soutenu Trump, en espérant qu’il baisse les taxes et les régulations, ont été passablement énervés par la façon dont sa campagne insurrectionnelle semble avoir accéléré l’effondrement du respect pour les institutions établies. Dugger a déclaré : « Les médias sont attaqués maintenant. Ils se demandent si le système judiciaire est le prochain sur la liste. Va-t-on passer des «fausses nouvelles» aux «fausses preuves» ? Pour les gens dont l’existence dépend de contrats exécutoires, c’est une question de vie ou de mort. »
Robert A. Johnson perçoit les discussions de fuite de ses pairs comme le symptôme d’une crise plus profonde. À 59 ans, Johnson a des cheveux argent ébouriffés, dégage un calme avunculaire et s’exprime d’une voix douce. Il a un diplôme d’ingénieur électrique et d’économie du MIT, un doctorat d’économie de Princeton et a travaillé à Capitol Hill avant d’entrer dans la finance. Il est ensuite devenu directeur du hedge fund Soros Fund Management. En 2009, après le début de la crise financière, il fut nommé à la tête du think tank de l’Institute for New Economic Thinking.
Lorsque j’ai rendu visite à Johnson, récemment, dans son bureau de Park Avenue South, il s’est lui-même décrit comme un étudiant accidentel de l’anxiété civique. Il a grandi dans la banlieue de Detroit, à Grosse Pointe Park. Fils de médecin, il a observé la descente aux enfers de la génération de son père à Detroit. « Ce que je vois se produire actuellement à New York a des airs de déjà vu, a-t-il déclaré. Ce sont mes amis. Avant, j’habitais à Belle Haven, à Greenwich, dans le Connecticut. Louis Bacon, Paul Tudor Jones et Ray Dalio (des gestionnaires de hedge funds) habitaient tous à une cinquantaine de mètres de chez moi. Lorsque je parlais aux gens, de plus en plus me disaient : «Tu dois avoir un avion privé, tu dois t’assurer de pouvoir prendre soin de la famille du pilote aussi, ils doivent être dans l’avion.» »
En janvier 2015, Johnson a tiré la sonnette d’alarme : les tensions provoquées par les énormes inégalités de revenus devenaient tellement importantes que les gens parmi les plus riches du monde prenaient des mesures pour se protéger. Au forum économique mondial de Davos, Johnson a confié à l’auditoire : « Je connais des gestionnaires de hedge fund à travers le monde qui achètent des fermes et des pistes d’atterrissage dans des pays comme la Nouvelle-Zélande car ils pensent qu’ils ont besoin d’un ticket de sortie. »
Johnson voudrait que les riches adoptent un plus grand esprit d’initiative, une ouverture pour le changement qui pourrait inclure, par exemple, des droits de succession plus agressifs. « 25 gestionnaires de hedge Fund gagnent plus d’argent que tous les enseignants qui travaillent dans les jardins d’enfants des États-Unis, a-t-il déclaré. Faire partie de ces 25 n’offre pas un bon sentiment. Je pense qu’ils sont devenus particulièrement sensibles. » L’écart s’agrandit. En décembre, le National Bureau of Economic Research a publié une nouvelle analyse, des économistes Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, qui a découvert que la moitié des adultes américains ont été « complètement écartés des bienfaits de la croissance économique depuis les années 70 ». Environ 117 millions d’Américains gagnent la même chose qu’en 1980, alors que le revenu moyen des 1 % a presque triplé. Cet écart correspond à l’écart moyen de revenus entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, écrivent les auteurs.
Johnson a dit : « Si nous avions une répartition plus équitable de la richesse, davantage de moyens et d’énergie déployés dans l’enseignement public, les parcs, les infrastructures de loisirs, les arts et la santé, cela pourrait grandement apaiser notre société. Nous avons largement liquidé ces choses. »
Alors que les institutions publiques se détériorent, l’anxiété des élites est devenue la jauge de notre situation délicate. « Pourquoi ces gens qui sont enviés pour leur pouvoir ont l’air d’avoir si peur ?, se demande Johnson. Qu’est-ce que cela nous dit vraiment sur notre système ?, a-t-il ajouté. C’est vraiment curieux. On a les gens les plus visionnaires, ceux qui ont les plus de ressources, parce que c’est ainsi qu’ils sont devenus riches… et ce sont ceux qui sont les plus prêts à sauter de l’avion et à actionner leur parachute. »
Durant une froide soirée du début du mois de novembre, j’ai loué une voiture à Wichita, dans le Kansas, pour prendre la direction du nord, en traversant la banlieue et en allant bien au-delà du dernier centre commercial, où l’horizon se garnit de terres agricoles. Après quelques heures, juste avant d’arriver dans la ville de Concordia, j’ai mis le cap sur l’ouest sur une route de terre traversant des champs de maïs et de soja, naviguant grâce à mes phares jusqu’à ce que j’arrive devant une énorme porte d’acier. Un garde, habillé en treillis, m’a accueilli avec un pistolet semi-automatique à la main.
Il m’a fait rentrer à l’intérieur et, dans la pénombre, j’ai pu voir les contours d’un énorme dôme en béton doté d’une porte métallique entrouverte (photo en en-tête). C’est alors que m’a accueilli Larry Hall, CEO du Survival Condo Project, un complexe d’appartements luxueux de 15 étages situé sous terre, dans un silo de missile Atlas. Avant de devenir un logement, le silo a accueilli entre 1961 et 1965 une tête nucléaire pour être ensuite mis hors service. Sur un site conçu pour la menace nucléaire soviétique, Hall a érigé une solution contre les craintes d’une nouvelle ère. « C’est un vrai soulagement pour les super riches, a-t-il déclaré. Ils peuvent venir ici, ils savent qu’il y a des gardes armés à l’extérieur. Les enfants peuvent jouer. »
Hall a eu l’idée de son projet il y a environ une décennie, lorsqu’il a lu que le gouvernement réinvestissait dans la gestion des catastrophes après un désintérêt suite à la fin de la Guerre froide. Durant les attaques du 11 septembre, l’administration Bush a activé un « plan de continuité du gouvernement », transportant des travailleurs fédéraux triés sur le volet en hélicoptère et en bus vers des lieux fortifiés. Mais après des années de désuétude, les ordinateurs et autres équipements des bunkers étaient complètement dépassés. Bush a alors ordonné de se repencher sur les plans de continuité, et la FEMA a lancé des exercices annuels (le plus récent, Eagle Horizon, en 2015, a simulé des ouragans, des engins nucléaires, des tremblements de terre et des cyberattaques).
« J’ai commencé à me dire : attends une minute, que sait le gouvernement que nous ignorons ? », a dit Hall. En 2008, il a payé 300 000 $ pour acheter le silo. La construction fut achevée en décembre 2012 pour un coût total d’environ 20 millions de dollars. Il a créé 12 appartements privés, tous sur un étage entier, qui furent mis en vente à 3 millions de dollars. Il les a tous vendus… sauf un, qu’il a gardé pour lui.
La plupart des preppers n’ont en fait pas de bunker. Ces abris blindés sont chers et difficiles à construire. Le silo original du complexe de Hall fut conçu par les ingénieurs de l’armée afin de résister à une frappe nucléaire. Il peut accueillir 75 personnes. Il dispose de suffisamment de nourriture et de carburant pour fonctionner 5 ans sans apport extérieur. En élevant des tilapias dans des bassins, en cultivant des légumes hydroponiques sous des lampes de culture avec des énergies renouvelables, il pourrait fonctionner indéfiniment, a déclaré Hall. En cas de crise, ses camions de style SWAT iront chercher n’importe quel propriétaire dans un rayon de 650 km. Les résidents possédant un jet privé peuvent atterrir à Salina, à une cinquantaine de kilomètres de là. Selon lui, les ingénieurs de l’armée firent le plus dur en choisissant le lieu. « Ils se sont penchés sur le niveau au-dessus de la mer, la séismologie des lieux, la distance avec les grands lieux habités », a-t-il expliqué.
Hall, la cinquantaine bien entamée, est un grand bavard au torse puissant. Il a étudié les affaires et l’informatique au Florida Institute of Technology. Il s’est ensuite spécialisé dans les réseaux et les centres de données au sein de Northrop Grumman et Harris Corporation, des fournisseurs de la Défense. Il fait désormais des allers-retours entre son silo du Kansas et sa maison de la banlieue de Denver où sa femme, assistante juridique, vit avec leur fils de 12 ans.
Hall m’a fait visiter le garage et un lounge avec feu ouvert, salle à manger et cuisine d’un côté. Il dégageait le charme d’un condo de ski, les fenêtres en moins : table de billard, électroménager en aluminium brossé, fauteuils en cuir. Pour rationaliser l’utilisation de l’espace, Hall s’est inspiré des cabines des paquebots de croisière. Nous étions accompagnés par Mark Menosky, un ingénieur qui supervise les opérations quotidiennes. Alors qu’ils s’occupaient du repas (steak, patates au four et salade), Hall a déclaré que l’aspect le plus compliqué du projet est d’organiser une vie durable sous terre. Les condos ont été équipés de « fenêtres à écran LED » qui diffusent la vidéo en direct du paysage qui se trouve au-dessus du silo. Mais les propriétaires peuvent choisir une autre vue, comme une forêt de pins. Une future propriétaire de New York City voulait la vidéo de Central Park. « Durant les 4 saisons, de jour et de nuit, a déclaré Menosky. Elle voulait les bruits, les taxis et les klaxons. »

Certains survivalistes dénigrent Hall pour avoir créé un refuge de luxe pour les riches et ont menacé de prendre son bunker en cas de crise. Hall a balayé cette possibilité lorsque je l’ai évoquée durant notre dîner. « Ils peuvent nous tirer dessus autant qu’ils veulent. » Si nécessaire, ses gardes riposteront, a-t-il déclaré. « Nous avons un poste de sniper. »
Récemment, je me suis entretenu au téléphone avec Tyler Allen, développeur immobilier de Lake Mary, en Floride, qui m’a déclaré avoir payé 3 millions de dollars pour acheter l’un des condos de Hall. Allen a évoqué sa crainte de conflits sociaux aux États-Unis, ainsi que les efforts du gouvernement pour tromper la population. Il pense qu’ils ont laissé entrer le virus Ebola dans le pays pour l’affaiblir. Lorsque je lui ai demandé quelle est la réaction de ses amis à ses idées, il a dit : « La réaction habituelle que l’on obtient, ce sont les rires, parce qu’ils ont peur. Mais, a-t-il ajouté, ma crédibilité a explosé. Il y a 10 ans, tout cela avait l’air juste fou… des troubles sociaux, une division culturelle dans le pays, des troubles raciaux et la propagation de la haine. » Je lui ai demandé comment il comptait rejoindre le Kansas, depuis la Floride, en cas de crise. « Si une bombe sale atteint Miami, tout le monde sera à la maison ou dans un bar, accroché à la TV. Eh bien, vous aurez 48 heures pour foutre le camp. »
Allen m’a dit que, selon lui, prendre ses précautions est injustement stigmatisé. « On ne vous traite pas de barjo si vous êtes le Président et que vous allez à Camp David, a-t-il rétorqué. Mais si vous avez les moyens et que vous faites le nécessaire pour protéger votre famille en cas de problème, on vous catalogue parmi les timbrés. »
Pourquoi nos pulsions dystopiques émergent à certains moments, et pas à d’autres ? La fin du monde, en tant que prophétie, genre littéraire ou opportunité commerciale, n’est jamais statique : elle évolue avec nos anxiétés. Les premiers colons puritains ont vu dans le trésor incroyable de la nature américaine à la fois l’apocalypse et le paradis. Lorsque, en mai 1780, la pénombre remplaça subitement le jour en Nouvelle-Angleterre, les fermiers pensèrent que ce cataclysme annonçait le retour du Christ (en fait, le phénomène fut provoqué par d’énormes feux de forêt en Ontario). D. H. Lawrence diagnostiqua une certaine propension américaine à avoir peur. « Ruine ! Ruine ! Ruine ! », a-t-il écrit en 1923. « Quelque chose semble le murmurer dans les forêts très sombres d’Amérique. »
Historiquement, notre fascination pour le jugement dernier a prospéré durant les périodes d’insécurité politique et de changements technologiques rapides. « À la fin du 19e siècle, des tas de romans utopistes furent publiés, et pour chacun d’entre eux un roman dystopique sortait aussi » m’a dit Richard White, historien de l’université de Stanford.
Le livre de Bellamy Looking backward, publié en 1888, raconte l’histoire d’un paradis socialiste en 2000. Il devint un roman culte, inspirant la création de clubs Bellamy à travers le pays. À l’inverse, Jack London, en 1908, a publié The Iron Heel, imaginant une Amérique sous la coupe d’une oligarchie fasciste dans laquelle « 1/10 dixième des 1 % » détient « 70 % de la richesse ».
À l’époque, les Américains s’émerveillaient des progrès de l’ingénierie. Les visiteurs de l’exposition universelle de Chicago de 1893 purent contempler les nouvelles applications de la lumière électrique. Mais, simultanément, ils dénonçaient les bas salaires, les mauvaises conditions de travail et l’avarice des patrons. « C’était fort similaire à aujourd’hui, a déclaré White. On avait le sentiment que le système politique avait déraillé et qu’il n’était plus capable de gérer la société. Il y avait d’énormes inégalités, une gronde chez les prolétaires. L’espérance de vie raccourcissait. Le sentiment que les progrès de l’Amérique s’étaient arrêtés se dégageait, on avait l’impression que tout allait tomber en lambeaux. »
Les poids lourds du business devinrent mal à l’aise. En 1889, Andrew Carnegie, qui allait devenir l’homme le plus riche du monde avec un patrimoine de plus de 4 milliards de dollars d’aujourd’hui, écrivait, avec inquiétude, sur les tensions entre les classes. Il a critiqué l’émergence de « castes rigides » vivant dans une « ignorance mutuelle » et une « méfiance partagée ». John D. Rockefeller, de Standard Oil, qui fut en fait le premier milliardaire américain, pensait qu’il était de son devoir chrétien de donner en retour. « La nouveauté d’être capable d’acheter tout ce qu’on souhaite vous passe rapidement, a-t-il écrit en 1909, car ce que les gens veulent le plus ne s’achète pas. » Carnegie a poursuivi en combattant l’analphabétisme en créant près de 3 000 bibliothèques publiques. Rockefeller a fondé l’université de Chicago. D’après Joël Fleishman, l’auteur de The Foundation, une étude de la philanthropie américaine, les deux hommes se sont appliqués à « changer le système qui a engendré ces maux ».
Pendant la Guerre froide, l’Armageddon devint un sujet pour les politiques. L’Administration fédérale de la Défense Civile, créée par Harry Truman, émettait des instructions claires pour survivre à une frappe nucléaire, comme de « sauter dans tout fossé » ou encore de ne « jamais perdre la tête ». En 1958, Dwight Eisenhower posa le pied sur Project Greek Island, un abri secret situé dans les montagnes de la Virginie de l’Ouest, assez grand pour accueillir tous les membres du Congrès. Caché derrière le Greenbrier Resort, à White Sulphur Springs, pendant plus de 40 ans, il tenait prêt des chambres séparées pour la Chambre et le Sénat (le Congrès a désormais un autre abri, dans un lieu secret).
Mais, en 1961, John Fitzgerald Kennedy encouragea « tous les citoyens » à contribuer à la construction d’abris contre les retombées radioactives. Dans une allocution télévisée, il a dit : « Je sais que vous ne voudriez pas en faire moins. » En 1976, surfant sur les craintes d’inflation et l’embargo du pétrole arabe, un éditeur d’extrême droite du nom de Kurt Saxon lança The Survivor, un bulletin d’information influent qui célébrait les connaissances perdues des pionniers. La littérature grandissante sur le déclin et l’autoprotection incluait des titres comme « Comment prospérer dans les mauvaises années à venir », un best-seller de 1979 qui conseillait d’accumuler de l’or sous la forme de pièces sud-africaines Krugerrands. Le « doom boom », comme on commençait à le connaître, s’est encore développé sous Ronald Reagan. Le sociologue Richard G. Mitchell Jr, professeur émérite de l’université de l’Oregon qui a passé 12 années à étudier le survivalisme, a déclaré : « Durant l’ère Reagan, nous avons entendu, pour la première fois de ma vie et je suis âgé de 74 ans, les plus hautes autorités du pays nous dire que le gouvernement n’avait pas été à la hauteur, que les méthodes collectives institutionnelles de résolution des problèmes et de compréhensions de la société ne sont pas bonnes. Les gens ont dit : ok, elles sont déficientes. Mais que faire maintenant ? »
Le mouvement a reçu un nouveau coup de pouce sous l’administration de George Bush, qui géra très mal l’ouragan Katrina. Neil Strauss, ancien reporter du Times, qui a chroniqué sa conversion au prepping dans son livre Emergency, m’a dit : « Nous voyons la Nouvelle-Orléans, où notre gouvernement sait qu’un désastre a lieu et qu’il est incapable de sauver ses propres citoyens. » Strauss s’est intéressé au survivalisme un an après Katrina, lorsqu’un entrepreneur dans la technologie qui prenait des leçons de pilotage et qui échafaudait des plans de fuite le présenta à un groupe de gens ayant les mêmes préoccupations, « des preppers milliardaires ou millionnaires par centaines ». Strauss a acquis la citoyenneté de St-Kitts, a mis une partie de son patrimoine dans des devises étrangères et s’est entraîné à survivre avec « rien d’autre que mes vêtements sur le dos et un couteau ».
Aujourd’hui, lorsque la Corée du Nord teste une bombe, Hall peut s’attendre à une augmentation des appels de demande de renseignements concernant les disponibilités du Survival Condo Project. Mais il met en évidence une source plus profonde de demande. « 70 % de la population n’aiment pas la tournure que prennent les événements », a-t-il déclaré. Après notre dîner, Hall et Menosky m’ont fait visiter les lieux. Le complexe est un haut cylindre qui ressemble à un épi de maïs. Certains niveaux accueillent des appartements privés, d’autres des facilités communes : une piscine de 23 m de long, un mur d’escalade, un parc pour les animaux de compagnie, une salle de classe dans laquelle sont alignés des Mac, une salle de gym, un cinéma et une bibliothèque. C’est compact sans être claustrophobe. Nous avons visité une armurerie dotée d’armes et de munitions en cas d’attaque extérieure, ainsi qu’une pièce dotée d’une seule toilette. « On peut y enfermer des gens pour leur donner à réfléchir », a-t-il expliqué. En général, les règles sont définies par l’association du condo, qui peut voter pour les modifier. Durant une crise, une situation « de vie ou de mort », chaque adulte devra travailler 4 heures par jour et ne pourra sortir sans permission, d’après Hall. « L’accès est contrôlé, que ce soit pour entrer ou sortir. Les règles sont définies par le comité », a-t-il précisé.

L’aile médicale dispose d’un lit d’hôpital, d’une table d’opération ainsi que d’une chaise de dentiste. Parmi les résidents, il y a 2 docteurs et un dentiste. À l’étage du dessus, nous avons visité les lieux où est stockée la nourriture, qui ne sont pas encore achevés. Il espère, lorsque tout sera rempli, que cela ressemblera à un supermarché « Whole Foods » en miniature. Mais, actuellement, il stocke principalement des conserves.
Nous avons fait un détour par un condo. Des hauteurs sous plafond de 2,75 m, une cuisinière Wolf, un feu ouvert au gaz. « Ce gars voulait un feu ouvert typique de son État, le Connecticut, donc il m’a expédié le granite », a dit Hall. Un autre propriétaire, des Bermudes, a demandé à ce que les murs de son condo-bunker soient peints en tons pastel des îles –orange, vert, jaune. Mais, après avoir découvert le résultat, il l’a trouvé oppressant. Son décorateur est venu corriger le souci.
Cette nuit, j’ai dormi dans une chambre d’amis dotée d’un bar et de jolies armoires en bois, mais sans « fenêtre à écran LED ». C’était sinistrement silencieux, j’ai eu l’impression de dormir dans un sous-marin bien aménagé.
Je me suis réveillé vers huit heures, le matin suivant, pour trouver Hall et Monovsky dans les communs, buvant une tasse de café et regardant les nouvelles de la campagne via « Fox & Friends ». C’était 5 jours avant l’élection présidentielle. Hall, qui est républicain, s’est décrit lui-même comme un supporter prudent de Trump. « Des deux tendances, j’espère que son sens des affaires prendra le pas sur son impulsivité. » En regardant les meetings de Trump et de Clinton à la télévision, il fut frappé par le nombre de gens, et leur enthousiasme, qui assistaient aux rassemblements de Trump. « Je ne crois tout simplement pas les sondages », m’a-t-il confié.
Il pense que les médias traditionnels sont partiaux. Il souscrit à des théories dont il sait que certains les trouvent invraisemblables, comme « des décisions prises délibérément par le Congrès pour abrutir la population américaine. » Pourquoi le Congrès ferait-il une chose pareille, lui ai-je demandé. « Ils ne veulent pas que les gens soient intelligents et comprennent ce qui se passe en politique », m’a-t-il répondu. Il m’a dit qu’il avait lu une prédiction affirmant que 40 % du Congrès sera arrêté à cause d’une affaire concernant les Panama Papers, l’Église catholique et la fondation Clinton. « Ils travaillent sur cette enquête depuis 20 ans », a-t-il dit. Je lui ai demandé s’il y croyait vraiment. Il n’a pas vraiment démenti.
Avant de prendre le chemin du retour pour Wichita, je me suis arrêté au dernier projet de Hall, un second complexe souterrain dans un silo situé à une quarantaine de kilomètres de là. Alors que nous nous arrêtions, une grue s’est profilée au-dessus de nos têtes, hissant des débris des profondeurs. Le complexe disposera d’une superficie 3 fois supérieure à celle du premier projet, notamment parce que le garage prendra place dans une structure séparée. Parmi les nouveautés, il y aura une piste de bowling et des portes-fenêtres LED pour améliorer la sensation d’espace.
Hall a déclaré travailler sur des bunkers privés dans l’Idaho et au Texas pour des clients, et que 2 sociétés technologiques qui lui ont demandé de concevoir « des facilités sécurisées pour leur centre de données, ainsi qu’un refuge pour les membres clés de leur personnel, au cas où ». Afin de répondre à la demande, il a déjà pris une option sur 4 nouveaux silos.
Si un silo dans le Kansas n’est pas assez privé ou éloigné, il y a une autre option. Dans les 7 premiers jours qui ont suivi l’élection de Donald Trump, 13 401 Américains se sont inscrits auprès des services d’immigration de la Nouvelle-Zélande, soit le premier pas officiel dans l’obtention de la citoyenneté. Soit 7 fois plus que d’habitude. Le New Zealand Herald a rapporté cette augmentation en titrant « L’apocalypse Trump ».
En fait, l’afflux avait commencé bien avant la victoire de Trump. Durant les 10 premiers mois de 2016, des étrangers ont acheté plus de 3 600 km² de terrains en Nouvelle-Zélande, plus du quadruple de ce qu’ils ont acheté à la même période de l’année précédente, d’après le gouvernement. Seuls les Australiens en ont acheté plus que les Américains. Le gouvernement américain n’enregistre pas le nombre de ses citoyens qui possèdent une ou plusieurs résidences secondaires à l’étranger. Alors que la Suisse attirait autrefois les Américains avec la promesse du secret, tandis que l’Uruguay les tentait avec des banques privées, la Nouvelle-Zélande offre la sécurité et la distance. Durant les 6 dernières années, près d’un millier d’étrangers ont obtenu la résidence en Nouvelle-Zélande via des programmes conditionnés à certains types d’investissement d’au moins 1 million de dollars.
Jack Matthews, un Américain qui est le président de MediaWorks, une grosse chaîne de télévision néo-zélandaise, m’a dit : « Je pense que dans la tête des gens, si le monde devait partir en couille la Nouvelle-Zélande est un pays de premier choix, complètement autosuffisant si nécessaire, en énergie, en eau et en nourriture. Le niveau de vie baisserait, mais il ne s’effondrerait pas. » Pour quelqu’un qui observe la politique américaine de loin, il m’a dit : « La différence entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis est que, globalement, les gens qui sont en désaccord ici savent encore se parler. C’est un grand village, il n’y a pas d’anonymat. Les gens doivent afficher de la civilité. »
Auckland se trouve à 13 heures de vol de San Francisco. J’ai atterri en Nouvelle-Zélande au début du mois de décembre, soit au début de l’été. Ciel bleu, température autour des 25 °, pas d’humidité. De haut en bas, la chaîne d’îles couvre la même distance qu’entre le Maine et la Floride, alors que la population totale est inférieure à celle de New York City. Il y a 7 fois plus de moutons que d’habitants. Dans les classements mondiaux, la Nouvelle-Zélande se trouve dans le top 10 pour la démocratie, l’honnêteté du gouvernement et la sécurité (son dernier souvenir du terrorisme date de 1985, lorsque des espions français bombardèrent un bateau de Greenpeace). Dans un rapport récent de la Banque Mondiale, la Nouvelle-Zélande a dépassé Singapour au classement des meilleurs pays pour les affaires.
Le lendemain matin de mon arrivée, Graham Wall, un agent immobilier enjoué spécialisé dans ce que sa profession décrit comme « des individus à hauts revenus » (comme Peter Thiel, le milliardaire spécialisé dans le capital-risque), est venu me chercher à l’hôtel. Il fut surpris d’apprendre que les Américains viennent précisément en Nouvelle-Zélande en raison de l’éloignement du pays. « Les Kiwis avaient pour habitude de parler de la «tyrannie de la distance», m’a dit Wall, alors que nous traversions la ville dans son cabriolet Mercedes. Aujourd’hui, cette tyrannie de la distance est notre meilleur atout. »
Avant mon voyage, je m’étais demandé si j’allais passer davantage de temps dans des bunkers de luxe. Mais Peter Campbell, directeur de Triple Star Management, société de construction néo-zélandaise, m’a dit que lorsque les Américains arrivent, et dans leur grande majorité, ils décident que les abris souterrains sont inutiles. « Vous ne devez pas vraiment construire un bunker en dessous de votre jardin, parce que vous êtes à des milliers de kilomètres de la Maison Blanche », m’a-t-il dit. Les Américains ont d’autres types de demandes. « Les hélisurfaces sont très demandées, m’a-t-il expliqué. Vous pouvez atterrir avec votre jet privé à Queenstown ou à Wanaka, puis un hélicoptère peut vous emmener directement jusqu’à votre propriété. » Les clients américains souhaitent également des conseils stratégiques. « Ils demandent, par exemple, si la Nouvelle-Zélande ne sera pas affectée à long terme par la montée du niveau des mers. »
L’appétit grandissant des étrangers pour l’immobilier néo-zélandais a généré des réactions négatives. La « campagne contre le contrôle étranger d’Aotearoa », le nom maori de la Nouvelle-Zélande, s’oppose à la vente de terrains à des étrangers. L’attention des survivalistes américains a particulièrement généré du ressentiment. Dans une discussion à propos de la Nouvelle-Zélande sur le Modern Survivalist, un site Web prepper, un commentateur a écrit : « Les Ricains, enfoncez-vous cela dans le crâne. Aotearoa NZ n’est pas votre petit refuge de dernier recours. »
Un gestionnaire de hedge fund américain dans la quarantaine, grand, bronzé et athlétique, a récemment acheté 2 maisons en Nouvelle-Zélande et a obtenu son titre de séjour. Il a accepté de me parler, mais uniquement sous le couvert de l’anonymat. Ayant grandi sur la côte Est, il m’a dit, autour d’un café, qu’il s’attend à voir les États-Unis traverser au moins une décennie de troubles politiques, incluant des tensions raciales, la polarisation des opinions et le vieillissement rapide de la population. « Le pays s’est divisé en région de New York, région de Californie, ensuite tout le reste au milieu est sauvagement différent », m’a-t-il déclaré. Il craint de voir l’économie souffrir si Washington se démène à financer la sécurité sociale et Medicare pour ceux qui en ont besoin. « Faites-vous défaut sur cette obligation ? Ou créez-vous davantage de monnaie pour l’assurer ? Quelles seront les conséquences sur la valeur du dollar ? Ce n’est pas un problème pour l’année prochaine, mais pas pour dans 50 ans non plus. »
La réputation de la Nouvelle-Zélande d’attirer des prophètes de malheur est tellement connue dans les cercles du gestionnaire de hedge fund qu’il préfère se démarquer des premiers arrivants. « Ce n’est plus uniquement à propos d’une poignée de dingos se souciant de la fin du monde », m’a-t-il dit. Puis, en riant, il a ajouté : « À moins que j’en fasse partie. »
Chaque année, depuis 1947, le Bulletin of the Atomic Scientists, un magazine fondé par les membres du projet Manhattan, rassemble un groupe de prix Nobel et autres luminaires afin de mettre à jour l’Horloge de l’Apocalypse, une jauge symbolique du risque de destruction de notre civilisation. En 1991, alors que la Guerre froide prenait fin, les scientifiques ont réglé l’horloge à son heure la plus sûre de son histoire, soit 17 minutes avant minuit.
Depuis, l’horloge tourne. En janvier 2016, après des tensions militaires grandissantes entre la Russie et l’OTAN, ainsi que l’année la plus chaude depuis que les statistiques climatiques sont compilées, le Bulletin a réglé l’horloge sur minuit moins 3, soit à son niveau de la Guerre froide. En novembre, après l’élection de Trump, le panel s’est à nouveau réuni pour tenir sa discussion annuelle et confidentielle. Si l’horloge avance encore d’une minute, elle atteindra un niveau d’alarme que nous n’avons plus connu depuis 1953, après le premier test américain d’une bombe à hydrogène.
Les peurs de désastre sont saines si elles enclenchent des actions visant à le prévenir. Mais le survivalisme des élites n’est pas une mesure de prévention, c’est un acte d’abandon. La philanthropie aux États-Unis reste 3 fois plus développée, proportionnellement au PIB, que le second pays où elle est la plus en vogue, le Royaume-Uni. Mais elle s’accompagne aujourd’hui d’un geste de renoncement, du désinvestissement silencieux de certains des Américains les plus puissants et les plus riches. Confrontés à l’évidence de la fragilité du projet américain, de ses institutions et de ses normes dont ils ont profité, certains s’autorisent à envisager l’échec. Il s’agit d’un désespoir doré.
Comme Huffman, de Reddit, l’a noté, nos technologies nous font plus prendre conscience des risques, mais elles nous font également paniquer davantage. Elles facilitent la tentation tribale de se réfugier dans son cocon, de s’éloigner de ses opposants et de se fortifier contre ses peurs au lieu d’attaquer leurs sources. Justin Kan, l’investisseur de la technologie qui a fait un effort peu convaincant pour stocker de la nourriture, se souvient de l’appel récent d’un ami d’un hedge fund : « Il m’a dit que je devrais acheter un terrain en Nouvelle-Zélande au cas où. Il m’a dit : quelles sont les chances que Trump soit en fait un dictateur fasciste ? Elles sont peut-être basses, mais la valeur d’avoir une porte de sortie est assez élevée. »
Il existe d’autres façons d’absorber les peurs de notre époque. « Si j’avais 1 milliard de dollars, je n’achèterais pas un bunker, a déclaré Elli Kaplan, CEO de la start-up Neutotrack. J’investirais dans la société civile et l’innovation civile. Je pense que nous devons trouver des solutions plus intelligentes pour éviter toute catastrophe. » Kaplan, qui a travaillé à la Maison Blanche sous Bill Clinton, fut effaré par la victoire de Donald Trump, mais il a expliqué que cela la galvanisait d’une autre façon. « Malgré mes peurs les plus profondes, je me dis que notre union est plus forte que cela. »
Cette opinion est, en fin de compte, un acte de foi – une conviction que même des institutions politiques détériorées sont le meilleur instrument de la volonté commune, les meilleurs outils pour modeler et faire perdurer notre consensus fragile. Croire en cela est un choix.
J’ai appelé un vieux sage de la Silicon Valley, Stewart Brand, l’auteur et entrepreneur qui avait inspiré Steve Jobs. Dans les années 60 et dans les années 70, le Whole Earth Catalog de Brand est devenu culte, avec son mélange de conseils hippies et technologiques. Brand m’a dit qu’il avait exploré le survivalisme dans les années 70, mais pas pendant longtemps. « En règle générale, je trouve que l’idée ‘oh mon dieu, le monde va se désintégrer’ est bizarre », m’a-t-il dit.
À 77 ans, vivant sur un bateau-remorqueur à Sausalito, Brand est moins impressionné par les signes de fragilité que par les exemples de résilience. Durant la dernière décennie, le monde a survécu, sans violence, à la pire crise financière depuis la Grande Dépression ; à Ebola, sans cataclysme ; et, au Japon, à un tsunami et une catastrophe nucléaire, après quoi le pays est reparti de l’avant. Il perçoit des risques dans la fuite. Alors que les Américains se réfugient au sein de petits groupes d’expérience, nous mettons en danger « le cercle large d’empathie », a-t-il déclaré, la recherche de solutions à des problèmes communs. « La question de savoir comment me protéger est simple. Mais la question de savoir si la civilisation peut continuer de survivre comme elle l’a fait durant les derniers siècles est plus intéressante. »
Après quelques jours en Nouvelle-Zélande, j’ai pu comprendre pourquoi certains préféraient éluder ces questions. Sous un ciel bleu azuré d’une matinée d’Auckland, j’ai embarqué dans un hélicoptère en compagnie d’un Américain de 38 ans, Jim Rohrsaff. Après l’université, dans le Michigan, Rohrsaff a gagné sa vie en tant que joueur de golf professionnel, puis dans le marketing pour des clubs de golf de luxe et l’immobilier. Optimiste et confiant, il a déménagé en Nouvelle-Zélande il y a 2 ans et demi avec sa femme et ses deux enfants, afin de vendre des propriétés aux individus à hauts revenus qui veulent « s’éloigner de tous les problèmes du monde », m’a-t-il dit.
Rohrstaff, copropriétaire de Legacy Partners, une agence de luxe, voulait me faire visiter Tara Iti, un nouveau projet de logements de luxe et de clubs de golf qui s’adresse principalement aux Américains. L’hélicoptère a pris la direction du nord en passant au-dessus du port pour ensuite longer la côte à travers des forêts luxuriantes et des champs, loin de la ville.
L’hélicoptère s’est posé sur une pelouse située à côté d’un green. Le nouveau complexe de luxe disposera de 3 000 acres de dunes et de forêts, de plus de 10 km de côtes, le tout pour seulement 125 maisons. Alors que nous visitons le site en Land Rover, il a insisté sur l’isolement. « De l’extérieur, vous ne verrez rien. C’est mieux pour les riverains et c’est mieux pour nous, pour l’intimité. »
Alors que nous approchions de la mer, Rohrstaff a arrêté le Land Rover et en est descendu. Chaussé de mocassins, il a traversé les dunes pour me mener jusqu’à une plage qui s’étendait jusqu’à perte de vue sans que l’on puisse voir une âme à l’horizon.
Il a ouvert ses bras, s’est retourné et a éclaté de rire. « Je pense que c’est l’endroit où il faudra être dans le futur », m’a-t-il dit. Pour la première fois depuis des semaines, et même des mois, je ne pensais pas à Trump. Ou même à autre chose.
« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur www.insolentiae.com. »